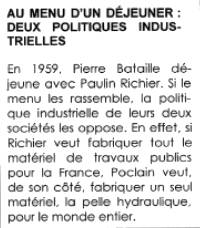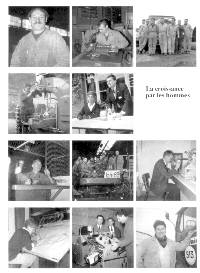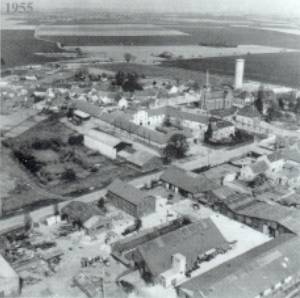Après la guerre, les « Ateliers de Poclain » avaient adapté un engin de chargement sur un Dodge 4 x 4 provenant des surplus américains. L'appareil actionné par câbles selon un
système Lambert pouvait soulever une charge de 1 tonne à 4 mètres de hauteur et était équipé soit d'une fourche soit d'un rateau ramasseur. Cet engin est depuis inscrit au catalogue, répondant sans pleinement convaincre à une des phases les plus pénibles des travaux agricoles : le chargement des remorques. Le besoin est sans doute là mais la solution technique se dérobe. Le mouvement le plus simple, le coup de fourche, la pelletée, semble encore une fois le plus dur à reproduire. Jusqu'au jour où, feuilletant une revue américaine, Georges Bataille découvre une petite machine de levage utilisant l'hydraulique et attelée à un tracteur. Ce procédé fait immédiatement vibrer sa passion de la mécanique, d'autant plus que
l'hydraulique a déjà été employée dans ses ateliers pour des chariots agricoles et du matériel à destination de l'Afrique. Son fils Pierre se passionne à son tour pour le procédé et avec l'ingénieur Gérard Coolen, les premiers croquis sont tracés. Il faut néanmoins être patient. La cinématique est difficile à mettre au point, l'engin que l'on veut simple, complexe à concevoir. Début octobre 1951, le premier essai du premier prototype tourne court. La haute pression fait éclater les circuits au bout de trois minutes, aspergeant d'huile son conducteur, Pierre Bataille, et les spectateurs attirés par cette démonstration peu ordinaire. Le potentiel est pourtant là et la construction d'un deuxième prototype est décidé. L'hiver se passe à tenter de le faire marcher, à modifier des pièces, à tester une à une les solutions possibles dans le contexte technologique de l'époque. Enfin, au Salon de la Machine Agricole de mars 1952, l'hydropelle TU est présentée pour la première fois au public. Elle n'est pas à vendre. Pierre Bataille et Jean Guillot qui le seconde, n'arrivent à la faire fonctionner que deux heures. Malgré cela, un homme insiste pour l'acheter, M. de Bosredon, déjà agent des « Ateliers de Poclain » à Bergerac. Ce dernier ne veut pas repartir sans cette machine. Elle ne marche pas mais cela n'a pas d'importance. Passionné de mécanique, il entrevoit les possibilités d'un tel engin. Pierre Bataille hésite, le met en garde. L'homme ne change pas d'avis et la vente se fait. M. de Bosredon est le premier client d'une hydropelle.
- Illustration 1 :
- Essai du dodge 4 x 4 équipé du système Lambert.
- Illustration 2 :
- Une pelle de démonstration à Bergerac. Montée sur GMC, elle est équipée d'un chargeur. L'équipement rétro est posé sur le plateau du camion.
La révolution de l'hydropelle

Conçue à l'origine pour le monde agricole, l'hydropelle va entraîner l'entreprise sur un autre marché, celui des chantiers. Ce glissement sera progressif. Les premières TU travaillent dans les champs, chargent les betteraves, le fourrage, le fumier. Des agriculteurs demandent des adaptations, le bureau d'études trouve des équipements, dépose des brevets. Dans ce contact permanent entre utilisateurs et fabricants, le matériel des Ateliers de Poclain progresse et des habitudes se créent. Habitude d'écouter le client, habitude d'étudier sur place les problèmes rencontrés, habitude d'intervenir immédiatement en cas de panne ou de difficulté. Cet état d'esprit où tout est fait pour bâtir une relation de confiance avec le client sera peu à peu systématisé et, devenu partie constituante de Poclain, débouchera en quelques années sur un des meilleurs Service Après-Vente de la profession. Dans un premier temps, cependant, l'hydropelle séduit d'abord par ses possibilités et par son prix. « La moins chère des pelles » peut être, en effet, tirée par un simple tracteur ou montée sur un camion. On commence à s'en servir pour tous les travaux durs, l'arrachage de souches, le curage des fossés. Son équipement se développe, Georges Bataille appliquant à l'hydropelle les principes industriels qu'il a instaurés pour ses remorques : un modèle de base permettant la construction en série et la polyvalence par les équipements. Cette polyvalence va peu à peu se retrouver dans la clientèle. Dans le monde des chantiers, la demande est forte. Un peu partout, la France passe de la phase de reconstruction à celle de l'équipement. L'heure est aux terrassiers. Des petits entrepreneurs se lancent et pour rentabiliser leurs travaux cherchent un matériel adapté et surtout bon marché. L'hydropelle correspond à leurs besoins. En 1952, une cinquantaine d'exemplaires sont vendus. En 1953, 350. Dans le même temps, l'effectif des « Ateliers » est monté à 209 personnes. Le bureau d'études ne s'en tient pas là : 2 000 TU sont en service en 1956 quand la TO est proposée en version tractée ou automotrice avec cinq équipements interchangeables dont le rétro. En parallèle, le même catalogue propose aux agriculteurs des remorques-épandeurs-déchargeurs de 3, 4 et 5 tonnes avec comme slogan publicitaire : « Un seul appareil toute l'année ». Ce message sera bientôt aussi vrai pour l'entreprise. Georges Bataille en est bien conscient. En accord avec ses fils, il concentre tous les efforts des « Ateliers » sur l'hydropelle.
- Illustration 1 :
- M. Vajsman aux commandes de la TU nº 2.
- Illustration 2 :
- En 1953, à Crépy, une TU à moteur auxiliaire Vendeuvre montée sur un camion Croley. De dos, Georges Bataille.
- Illustration 3 :
- Mécano-soudure de la TU au Plessis.
- Illustration 4 :
- Ligne de montage des épandeurs.
- Illustration 5 :
- Affiche publicitaire de l'Épandeur - Déchargeur.
Quelques hommes, quelques noms

Des 9 ouvriers de 1930, il reste encore 25 ans plus tard aux « Ateliers de Poclain » Robert Delarue, Léon Vandenhaesevelde, Maurice Vandorpe, Émile Marin et Lucien Vailliet. En 1955, Mme Léone Emery a elle-aussi plus de vingt ans de maison, tout comme Raymond Dumondel, Albert Bulté, dit Bouboule, ou Pierre Delarue. Il y en a d'autres, bien sûr, avec pour certains moins d'ancienneté mais tout autant d'enthousiasme. En fait, l'entreprise entière se mobilise pour l'hydropelle. Qui n'a pas vu revenir d'une démonstration ratée Robert Blondiau ne peut comprendre cette rage de ne pas avoir été le meilleur. Ayant claqué la portière de sa 2 CV, le vendeur s'engouffre dans l'usine, criant à qui veut l'entendre que la pelle concurrente lui a pris trois mètres, à lui, Blondiau ! Il fonce dans l'atelier, répète à Albert Bulté ce qui lui est arrivé, explique ce qui, d'après lui, améliorerait les performances de cet équipement. Et la modification se fait immédiatement selon la technique du « plan au chalumeau ». Roger Quartier, M. Roulon, également à la vente, ont le même enthousiasme, un esprit maison qui semble habiter aussi bien Hubert Tronchon, le « créatif », que Félix Trangosi, le financier, Jean Guillot que Jean Patel, M. Rauch qu'André Lenart ou André Guéret, le spécialiste des concessionnaires. Cet esprit est communicatif et déteint sur une bonne partie de la clientèle. M. Viet à Oissery est ainsi le premier client des « Ateliers » à mettre une machine derrière son tracteur. Avec lui, la société du Plessis met au point un chargeur niveleur. Même goût pour les innovations chez M. Morel qui, exploitant agricole, achète un Dodge 4 x 4 équipé d'un système de levage. Puis chez un de ses fils, Hector, qui crée quelques années plus tard sa propre entreprise de travaux agricoles et acquiert pour cela une TU. Satisfait, il se lance en 1958 dans les travaux publics avec une TP300. Même foi dans ce nouveau produit, son développement, ses possibilités chez les premiers agents : MM. de Bosredon à Bergerac, de Bohan à Reims, Langlois à Tours, Barraud à La Rochelle, ou Amiand aux Sables-d'Olonne. Des personnalités pour ne pas dire des personnages. Car la force des « Ateliers de Poclain » est de ménager aussi bien pour son personnel que pour ses partenaires ou ses clients des espaces de liberté où l'esprit d'initiative et la personnalité peuvent s'exprimer. Et ce, même si au départ de l'action, préside une stratégie industrielle et commerciale rigoureuse et, par de nombreux aspects, novatrice.
- Illustration 1 :
- Un TP 300 équipement chargeur.
Une gamme et des actions
De 1952 à 1961, la gamme s'étoffe, se modernise, gagne en fiabilité et en puissance. Successivement, la TL, la TYA, la TP300 sortent des usines. Une huile rouge spéciale Poclain est mise au point, les équipements se multiplient, se standardisent. En 1960, une école de conduite est créée : elle offre une semaine de stage aux conducteurs de pelles des clients de Poclain. Son but : optimiser l'exploitation du matériel Poclain ; fidéliser l'entreprise en fidélisant le conducteur (quand on apprend à travailler sur une Poclain, on continue sur une Poclain) ; offrir un service en plus et par là se démarquer de la concurrence. Enfin, en octobre 1961, une manifestation de quatre jours dévoile à 900 invités, à la presse et à la télévision, la TY45, une pelle hydraulique automotrice à rotation totale et la TP30, remplaçante de la TP300. Cette présentation est d'importance et précédera de peu l'abandon définitif de la fabrication de matériel agricole en général et des épandeurs en particulier, ces derniers étant cédés à l'entreprise Mouzon. Pour les « Ateliers de Poclain » devenus à ce moment là Poclain, la révolution par l'hydropelle a bien eu lieu.
- Illustration 1 :
- Une TY A équipement chargeur.
- Illustration 2 :
- Une TY A équipement rétro sur la BAUMA de Munich en 1958.
La TY45

Comme une star ! Dix ans après la première pelle, Poclain met en œuvre tout son savoir-faire en matière de promotion et de relations publiques pour la sortie de la TY45. Ce baptême est un véritable évènement où discours, films, démonstrations, visites commentées, alternent avec les festivités proprement dites. Un lancement à l'américaine, digne des plus beaux paquebots. Il a fallu en fait dix ans d'évolutions pour permettre cette révolution. Intégrant l'expérience acquise, le Bureau d'études, les Méthodes et l'Atelier ont repensé entièrement la pelle hydraulique. La TY45 est une nouvelle machine jusque dans sa conception. Pour la première fois, conduite par Technès, une étude marketing de grande ampleur a été réalisée. Enquêtes commerciales et techniques, consultations de clients, de revendeurs, de conducteurs, l'analyse des besoins exprimés a permis la définition d'un cahier des charges précis. G. Guinot, directeur du Bureau d'études, a pu, de cette manière, travailler d'une façon analytique les différents points clés. Ainsi, l'hydraulique, le châssis, les équipements et le moteur ont été entièrement revus. La rotation totale a été mise au point. Outre les nouveautés techniques, les améliorations et les transformations, chaque pièce de la TY45 a été étudiée en fonction du prix de revient et de la qualité. Autre innovation, le développement d'un véritable programme d'esthétique industrielle. « Le beau est fonctionnel ». Partant de cette affirmation, Jean Parthenay a stylisé le châssis en pont de bateau et caréné l'ensemble moteur cabine, par des lignes nettes et sobres. Le rond à galet de grande dimension donne confiance, l'écart tourelle-châssis, réduit au minimum, n'inflige aucune rupture à l'œil, la ligne générale obtenue conférant à la machine un aspect plus ramassé, plus solide. L'habitacle de la TY45 n'a pas été oublié
séparé du moteur, il présente une couleur reposante, un siège confortable, des manettes dont l'ergonomie a été particulièrement soignée. La visibilité dans la cabine a été améliorée, cette dernière étant de plus rabattable pour le démontage. La peinture extérieure, habituellement négligée dans ce type d'engin, a cette fois donné lieu à des recherches : le rouge est plus vif, le toit de la cabine et la porte sont gris clair tandis que le dessus du châssis est noir. également noire, une bande souligne la tourelle. Aucun détail n'a été négligé, jusqu'au graphisme POCLAIN qui a été modifié pour s'adapter à la ligne carrée du carrossage. En résumé, pour la TY45, il faut plaire et être utile. La nouvelle pelle hydraulique à rotation totale a été conçue avec passion pour devenir la locomotive de l'entreprise. Tout Poclain s'est mobilisé pour sa naissance. Tout Poclain va se trouver entraîné par son formidable succès.
- Illustration 1 :
- Une TY 45 en démonstration sur le terrain de montagny.
- Illustration 2 :
- Une TY 45 équipement benne en démonstration.
L'international comme objectif
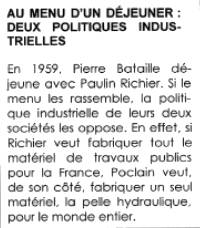
En l961, l'Oscar de l'Exportation récompense les efforts de l'entreprise à l'étranger. L'aventure internationale a, en fait, réellement commencé le 4 janvier 1956 avec la création de la société filiale Deutsche Poclain G.m.b.H. Au départ, Georges Bataille est peu favorable à cette idée. Son fils Jacques, directeur commercial et ardent partisan du projet, sait, avec l'appui de son frère Pierre, alors directeur technique, le convaincre de la nécessité de l'opération. Il faut grâce à ce produit nouveau, la pelle hydraulique, prendre de vitesse la concurrence. S'implanter le plus possible et le mieux possible avant que d'autres ne réagissent et se positionnent. Le long terme en dépend. Ce pari d'une implantation à l'étranger correspond également à l'obligation de trouver des marchés, de développer les séries pour abaisser les coûts, enfin de se rapprocher d'une clientèle qui fait confiance à Poclain. Sur ce dernier point, Georges Bataille ne peut être que d'accord. En tant qu'industriel, il ne conçoît la vente que comme le début d'une relation et aime à répéter qu'il vaut mieux ne pas vendre que vendre mal. Dans ces conditions, il est impossible d'exporter une machine sans offrir sur place les services de conseils et d'après-vente dont bénéficient un client de l'Oise. L'international est non seulement un objectif mais aussi un devoir. Jacques Bataille sera le maître d'œuvre de cette politique.
En France, le réseau commercial compte, en 1961, 35 concessionnaires et les succursales de Toulouse, Marseille et Lyon. A l'étranger, la création de la société filiale Poclain S.A. en Belgique le 19 juin 1959 et, le 20 décembre 1961, celle de Poclain Italiana S.P A. à Milan répondent à cette volonté commerciale. Dans les autres pays d'Europe, des concessionnaires assurent ce rôle, permettant à l'entreprise de vendre aux Hollandais, aux Anglais, aux Suisses, aux Danois et aux Norvégiens 25 % de sa production. Au Japon, Pierre Bataille traite avec la firme Yutani, installée à Hiroshima, pour la fabrication des TY45. Au Canada et aux USA, c'est Jacques Bataille qui étudie le marché nordaméricain, ses possibilités et les formes d'implantations réalisables.
La croissance par les hommes
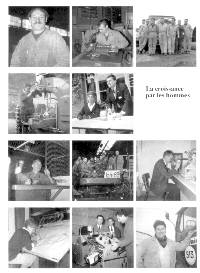
En 1950, 90 personnes travaillaient aux « Ateliers de Poclain ». Douze ans plus tard, ils sont 1 104. Cette progression qui touche aussi bien les ouvriers que les agents de maîtrise et les cadres ne va pas sans problèmes organisationnels et humains. Ateliers, bureaux, magasins, vestiaires, restaurant, suivent avec peine cette expansion. De nouvelles machines-outils font leur apparition, les techniques s'adaptent, se rationalisent. En 1960, une étude chronométrée est réalisée sur tous les postes de travail, évaluant la durée d'utilisation des machines, celle des déplacements de l'ouvrier et des pièces qu'il usine. Des aménagements sont effectués, des plans de montage modifiés. Corollaire du nombre, les problèmes de sécurité font l'objet de nombreuses réunions entre le comité d'entreprise et la direction. Des consignes sont édictées, des campagnes d'information lancées. « Poclain est là pour nourrir des hommes pas pour les tuer », répète Georges Bataille. Entouré de ses deux aînés, Jacques et Pierre, et de son fils Claude qui les a rejoints en 1959 après avoir terminé Centrale, il continue à se dépenser pour ce qu'il appelle « la boîte » ou, dans ses moments de fierté, « une bonne maison ». Pourtant, dans les éditoriaux du Poclain Journal qu'il lui arrive de signer ou à l'occasion d'une lettre adressée à l'ensemble du personnel pour les fêtes, il regrette de ne plus pouvoir connaître chacun comme par le passé. Pire, de n'avoir pas une salle assez vaste pour les réunir. Les anciens comprennent, les jeunes sont moins sensibles. Les temps changent et les équipements aussi, de l'achat d'un camion multibenne pour évacuer les déchets et remplacer d'antiques tombereaux à l'acquisition d'un ordinateur IBM 1401 pour réaliser les opérations de comptabilité, de paie et de stock, de la construction de nouveaux bureaux à l'agrandissement du parc à fer, d'une entrée d'usine refaite à l'installation de fours de traitements de forte puissance. Pour la direction, le plus dur est de hiérarchiser les besoins et d'organiser l'investissement. De garder, dans cette formidable expansion, la tête froide sans perdre de son enthousiasme. Autour du « patron », de ses fils Jacques pour la direction commerciale et Pierre pour la direction technique, des hommes sont en charge de cette mission : Pierre Ravery, pour la production, Félix Trangosi pour les finances, Georges Bader pour les achats, Hubert Tronchon pour la communication, Roger Quartier pour les ventes en France, Georges Kouck, pour le personnel et Jean Chevalier, pour la formation. Comme les autres, ces deux derniers ont fort à faire : dans l'Oise, la main d'œuvre spécialisée n'existe pas. Les villages sont essentiellement agricoles et les traditions ne sont pas celles de l'industrie mais celles de la terre. Mais là aussi, les choses changent : les fermes qui employaient après la guerre 1 ouvrier pour 10 hectares, en sont désormais à 1 ouvrier pour 50 hectares. La mécanisation est en route et ce mouvement ne s'arrêtera plus. Pour beaucoup d'habitants de la région, le reclassement devient une obligation. Sur place ou ailleurs, il faut trouver du travail. Dans ce contexte, Poclain est une opportunité et une chance. En plein essor, l'entreprise a besoin d'hommes mais, excentrée par rapport à Paris, ne peut recruter qu'exceptionnellement dans la capitale. A contrario, elle trouve difficilement dans l'Oise les qualifications nécessaires. Déjà, en 1948, la création de l'école des apprentis avait répondu à cette situation. Cette fois encore, la Direction comprend rapidement que la seule solution est d'assurer elle-même la formation de son personnel. D'organiser, en l'absence de structure régionale, essais professionnels, cours, stages, sessions. D'investir largement pour faciliter l'accès aux qualifications, prenant en charge les fournitures des cours par correspondance ou les enseignements pratiques. En quelques années, Poclain va savoir reconvertir des centaines d'ouvriers agricoles en ouvriers spécialisés. Et, encourageant toute volonté de promotions, permettre à bien des éléments de valeur de se faire connaître.