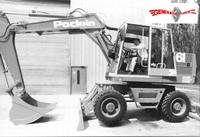ÉPOQUE 1978-1985
Créée en, 1842 par Jérôme Increase Case, la société Case est à l'origine spécialisée dans le matériel agricole. Son histoire n'est pas sans ressemblance avec celle de Poclain. Son fondateur mit en effet au point une des premières machines de labourage à vapeur avant de développer les tracteurs à essence, puis les batteuses. En 1963, Case était représenté par 125 distributeurs dans le monde et exportait 20 % de sa production. Diversifiant dès 1910 ses activités, la société s'organise en 1967 autour de trois divisions indépendantes : matériels pour l'agriculture, matériels pour la construction, et composants. 1970 voit Tenneco acquérir la totalité du capital de Case et poursuivre le développement de ce qui est devenu sa filiale. En 1983, Case est le deuxième constructeur américain de matériels de travaux publics et se situe au troisième rang mondial derrière Caterpillar et Komatsu. Les ventes de matériels de construction, entre autres les bakhoes, chargeurs, bulldozers, rouleaux-compacteurs, les pelles et les grues industrielles représentent 60 % de son chiffre d'affaires. Le matériel agricole, essentiellement constitué de tracteurs, et les composants 40 %. Cette dernière division produit certaines pièces hydrauliques comme les vérins et les valves. En ce qui concerne les moyens de production, Case possède 18 unités de fabrication dont 10 aux USA. 19 000 personnes (11 300 en Amérique du Nord) ont réalisé en 1983 1 752 millions de $ de chiffre d'affaires. Enfin, le réseau de distribution compte 1 200 points de vente en Amérique du Nord et 1 900 à l'étranger.
Tenneco
Si Case est un poids lourd de l'industrie, Tenneco est un géant. Cet énorme groupe, opérant dans le pétrole, le gaz, la chimie, la distribution, la construction mécanique, les produits agricoles, le secteur foncier ou les assurances, emploie plus de 96 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 14,5 milliards de $ avec un bénéfice net de 716 millions. 20 % des actifs de Tenneco se situent en dehors des États-Unis et les 2/3 en Europe, principalement en Grande-Bretagne. Quant aux divisions de Tenneco, elles disposent d'une large autonomie. La Direction Générale ne fixe qu'un objectif : « Être le premier dans sa spécialité. »
L'embellie : 1978-1981

Pour Poclain, 1978 voit un retour à l'équilibre. Les ventes en France se sont raffermies, le marché semble redémarrer. Pierre Bataille est toujours président du Groupe français et, avec son accord, un américain, David S. Bigelow, est nommé en 1980 directeur de la Division Pelles. En fait, de 1978 à 1981, durant quatre exercices, Poclain renoue avec les bons résultats : 2 155 millions de francs de chiffre d'affaires, 2 408, 2 747, enfin 3 153 en 1981 pour des bénéfices de 15, 100, 104 et 40 millions de francs. Les investissements suivent, passant de 28 millions de francs en 1978, à 31, 48, puis 92 millions en 1981. Au niveau de l'organisa?tion du groupe, il a été décidé de recentrer les activités sur les lignes de produits considérés comme prioritaires : les pelles, les grues et les composants hydrauliques. Les compacteurs sont abandonnés et Derrupé est cédé à la société allemande IBH. À l'inverse, les pelles électriques de forte puissance et une mini-pelle, la 35 CK, sont développées ainsi qu'une nouvelle gamme d'outils. En ce qui concerne la production, l'heure est à la spécialisation des usines par type de produit et au retour de certains travaux auparavant sous-traités. Pour une plus grande cohésion, les usines de l'Oise sont regroupées sous une direction unique et la liaison logistique Production-Commercial est renforcée. De 1978 à 1981, les investissements les plus importants concernent les pelles et les grues. Les dépenses engagées, comme l'achat d'installations à commandes numériques à hautes performances, visent toutes à améliorer la productivité. Les effectifs, eux, se maintiennent à peu près au même niveau, baissant légèrement pour le groupe de 7 265 à 7 243 et augmentant pour Poclain SA de 3 408 à 3 522. Formation et information sont deux leitmotive de la société. En 1979, 900 personnes ont participé à un stage de formation, un chiffre en augmentation de 30 % sur l'année précédente. Quant à l'information, elle est consolidée verticalement par une meilleure circulation des résultats de l'entreprise, des évolutions de l'environnement, du marché et de la concurrence. Un Comité de coordination du Groupe est également instauré, comprenant 14 membres sous la présidence de Pierre Bataille. Mêmes efforts pour les relations horizontales entre les services et les directions des divisions. Plus globalement, cette politique volontaire en matière d'information et de communication s'appuie toujours sur les deux publications de l'entreprise, « Poclain Journal » et « lnter-Poclain ».

La célébration du cinquantenaire de Poclain et l'organisation d'un Prix Georges Bataille en 1980, la création de l'Ordre du Mérite Poclain l'année suivante, forment un faisceau de manifestations destiné à forger un peu plus l'identité de l'entreprise. Le commercial n'est pas oublié et, à Expomat 1981, le Groupe lance l'opération « Poclain Max », campagne destinée à valoriser l'ensemble des services Poclain. Dans ce but, les effectifs de l'assistance technique sont augmentés. Du côté du réseau, si Poclain devient le premier distributeur Volvo BM dans le monde, hors Suède, l'entreprise est dans l'obligation de racheter trois concessionnaires en difficulté, à Dijon, Bourges et Rouen. Ces reprises sont révélatrices.
Alors qu'à l'étranger la situation s'est améliorée, permettant, au moins provisoirement, la restauration des grands équilibres économiques mondiaux, en France, la conjoncture reste médiocre. Taux fiscaux élevés, crédit étroitement encadré, programmes d'investissements limités pèsent sur l'économie du pays. En cinq ans, de 1975 à 1980, les dépenses salariales ont augmenté de 74 % alors que l'indice des prix industriel progressait de 40 % et celui des prix à la consommation de 47 %. Ce malaise va se transformer en véritable crise lorsque le marché mondial chutera une nouvelle fois à partir du deuxième semestre
1981. Cette année-là, Poclain gagnera pourtant encore des parts de marché.
Une manifestation exceptionnelle


Le Dimanche 28 septembre 1980, les 10 usines du groupe Poclain de l'Oise et du Nord sont ouvertes pour la journée du Cinquantenaire. Définie par Pierre Bataille, cette journée doit se placer essentiellement dans un cadre familial et doit permettre à tous les collaborateurs Poclain de montrer leur lieu de travail à leurs famille et amis. Michel Capelle et son équipe sont en charge de l'organisation générale. Ainsi, de 10 heures à 17 heures, dans chaque unité, le programme qui se veut à la hauteur de l'évènement verra pour chaque invité la remise d'un livret d'informations contenant tous les

renseignements sur le groupe Poclain, les caractéristiques particulières de l'usine visitée et un plan permettant de passer devant les postes d'une façon logique. Suivront une exposition du cinquantenaire, la projection du film « Les territoires Poclain », primé au Festival International de Biarritz, un jeu de piste pour les enfants, « Fiston futé », des expositions d'artistes, des démonstrations de pelles, un concours de conduite pour les spécialistes Poclain (avec, entre autres épreuves,

boucher une bouteille, prendre un œuf ou jouer aux quilles avec une benne), des initiations à la conduite d'engins (même pour les enfants), des courses à pied, un concours de tir à l'arc et bien d'autres animations
telles que des clowns à SMT, des majorettes à Carvin, un spectacle folklorique polonais à CMC. Sans oublier, évidemment, des buvettes, des tombolas et les
fameuses frites de Verberie. Ce jour-là, 30 000 personnes répondront à l'invitation et profiteront sous le soleil de cette ambiance de fête. Trois mois plus tôt, le 26 juin, ils avaient été plus de 500, 500 amis, collaborateurs, clients, invités à un grand dîner de gala Salle Wagram à Paris. Au programme, outre le menu, discours, spectacle et danse.
Nouvelles turbulences

En 1982, la situation économique mondiale se dégrade fortement. La production des sept plus grands pays industrialisés chute en moyenne de 5 %. La France, elle, suit le mouvement quand elle ne le précède pas. L'activité dans le Bâtiment connaît son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans et les Travaux Publics accusent le même recul. Dans le monde, le marché de la pelle hors Japon baisse de 13 % et celui des grues mobiles de 21 %. Ces tendances se répercutent aussitôt : en 1982, Poclain S.A. perd 252 millions de francs et l'ensemble du groupe 282 millions. Une nouvelle restructuration est alors décidée. Une augmentation de capital de 252 millions de francs est souscrite entre le 14 mars et le 12 avril 1983, augmentation couverte à hauteur de 40 % par Case- Tenneco et de 10 % par l'Emir Zeid Sudairi, distributeur de Poclain depuis 14 ans en Arabie Saoudite. Désormais, la répartition du nouveau capital social de 409 488 500 francs est la suivante : Tenneco 40 %, Établissements bancaires et financiers 25,45 %, Investisseurs institutionnels et autres 12,34 %, Emir Sudairi 6,15 %, Famille Bataille 5,92 % et Public 10,14 %. Des prêts à long terme pour un montant de 430 millions de francs accompagnent cette opération. Ces mesures sont complétées par un changement dans la forme de la direction de la société. Celle-ci se trouve à présent dirigée par un Conseil de Surveillance et un Directoire. Pierre Bataille est le Président de ce Conseil à majorité américaine, le président du Directoire étant quant à lui, David S. Bigelow. À dater de ce jour, la direction effective de Poclain n'appartient plus à un représentant de la Famille Bataille.
Premières décisions
Elles vont être à la mesure des difficultés: fermeture de l'usine SMT de Vaulx-les-Tournai en Belgique, réduction des activités en Espagne, chômage partiel dans les usines de l'Oise, effectif du Groupe diminué de 11 %. Ce plan de réorganisation industrielle est destiné, d'une part à ramener la capacité de production de l'entreprise au niveau de la demande d'un marché qui, en 3 ans, a diminué de 25 % en volume, et d'autre part à recentrer les productions sur les usines françaises. Il s'accompagne d'investissements importants, essentiellement programmés sur Crépyen-Valois. Ce site doit regrouper la fabrication des pel MF seront ainsi consacrés à l'amélioration des installations de peinture et des moyens de manutention, une optimisation destinée à correspondre à une production de séries moyennes continues. De même, l'activité tôlerie de Compiègne sera transférée à Crépy. Là, la fabrication des cabines et des réservoirs sera organisée en ilôts de production totalement autonomes, responsables de leur fabrication, peinture, câblage, montage.
La montée en production de la gamme « B&bsp;» intervient dans ce contexte. Conception du châssis, puissance de levage, confort, économie d'énergie, outillage, les nouvelles pelles commercialisées en 1982 et 1983 incorporent de nombreuses évolutions. Dans la classe des 12 tonnes, un essai comparatif réalisé face à douze machines concurrentes, met en valeur la nette supériorité du modèle Poclain. Cette gamme « B » semble donc techniquement bien née.
Tour d'horizon

La qualité des machines ne peut tout, il faut des clients. En 1983, Poclain voit son marché principal, le marché français, baisser de 32 % par rapport à l'année précédente. En Europe, la situation sans être euphorique est moins catastrophique. Dans son ensemble, le marché de la pelle, hors France, a progressé de 10 %. Ainsi, en Grande-Bretagne, malgré
la forte poussée des japonais,
Poclain reste le premier constructeur. Même réussite en RFA et, dans une moindre mesure en Italie, et dans les pays scandinaves. De l'autre côté de l'Atlantique, le continent américain affiche une très légère reprise, J.I. Case recommençant peu à peu ses approvisionnements, concentrant son action sur 2 modèles, la 160 et la 220. Par contre, la plupart des pays d'Amérique latine se sont effondrés, le Chili, la Colombie et le Pérou conservant seuls une activité significative. La conjoncture est tout aussi inquiétante en Afrique même si des contrats intéressants se concrétisent en Algérie, en Irak et en Afrique du sud. Les pays du Golfe sont eux, en nette amélioration. Les licenciés de Poclain en Extrême-Orient enregistrent de bons résultats : en Inde, le groupe Larsen & Toubro a renforcé sa position de leader sur le marché de la pelle hydraulique et, en Corée, dans un marché dynamique, Samsung a mis en production plusieurs modèles sur pneus et chenilles.
PPM et Poclain Hydraulics subissent aussi les aléas du marché et la pression de la concurrence. En 1982, la baisse d'activité en France pour les grues mobiles est d'environ 30 %. Avec une nouvelle gamme, PPM réussit néanmoins à maintenir le volume de ses ventes et à développer son chiffre d'affaires de 12 %. L'entreprise a effectué d'importants investissements pour améliorer sa productivité, multiplié les adaptations spéciales pour assurer ses positions. Elle a enfin fait progresser ses ventes internationales et alléger ses effectifs.
Chez Poclain Hydraulics, le marché des vérins est stagnant mais les ventes de moteurs et d'hydraulique générale ont augmenté de près de 20 %. Malgré cela, le chiffre d'affaires, en légère baisse, affiche des pertes. En conséquence, outre une réduction des effectifs et un arrêt des investissements lourds, la recherche d'un partenaire est à l'ordre du jour.
Perspective
En 1983, le ratio d'endettement de Poclain représente trois fois la situation nette de l'entreprise. Le montant des dettes à court, moyen et long terme est équivalent à 8 mois de chiffre d'affaires. La direction de Poclain juge alors qu'il est désormais impossible d'adapter timidement les moyens aux circonstances. Elle constate que la pelle hydraulique est devenue un produit banalisé et que le combat se situe moins au niveau de la technologie qu'au niveau des prix. Dans cette idée, le Directoire, après accord du Conseil de Surveillance, décide pour le Groupe d'une nouvelle stratégie: produire les pelles les moins chers du marché et doubler le rendement. Une grande partie de la politique de communication de l'entreprise va se trouver consacrée à mobiliser le personnel sur ce changement.
Communication et information: des composantes historiques de Poclain

De la première notice au Journal Parlé, du n° 1 du « Trois Roues » au Poclain-Journal, d'Inter-Poclain aux films, aux conférences de presse, aux manifestations, toute l'histoire de l'entreprise du Plessis-Belleville est marquée par cette volonté de communiquer. À l'heure des difficultés, ce réflexe n'est pas oublié. Une lettre mensuelle d'information, La Lettre Poclain, a été créée le 5 mars 1982. Depuis cette date, tous les membres de l'encadrement reçoivent personnellement et chez eux ce document. En plus de l'information économique sur les marchés et la profession, cette lettre permet de suivre au travers d'indicateurs la situation de l'entreprise et ses résultats. Le Poclain-Journal, quant à lui, reste fidèle à sa nouvelle formule. Bimensuel, il est distribué à l'ensemble du personnel avec un double rôle: d'abord, informer sur les services, les
hommes
et leurs réalisations, ainsi que sur les événements de la vie du Groupe. Ensuite, expliquer clairement et le plus concrètement possible, les décisions qui sont prises et les changements qui interviennent. De son côté, Inter-Poclain continue comme par le passé d'informer sur la réalité des chantiers et des clients. Au chapitre des nouveautés, en place depuis 1983, les informations télex permettent de suivre au plus près les événements. Grâce aux possibilités offertes par « Pogam », tout événement ou information d'actualité peut être rapidement porté à la connaissance du personnel. Ce système est en pleine évolution. Déjà, ces « messages télex » se trouvent affichés sur les 250 écrans d'ordinateurs, « les avis info RP », et le développement de l'informatique permettra d'améliorer encore dans l'avenir la rapidité de diffusion et l'audience de ces messages. En externe, campagnes publicitaires nationales et internationales, animation réseau, garantissent la présence du Groupe sur tous les marchés.
Le plan industriel de 1984

Synthétisant les analyses et les études réalisées en 1983, un plan industriel en 8 points présente les conditions du redressement de la société.
- Programme d'actions à court terme de réduction des prix matière, des stocks et des frais généraux.
- Programme de réduction des coûts sur les pelles de la gamme actuelle.
- Programme de restructuration industrielle centrée sur l'usine de Crépy.
- Lancement d'une nouvelle gamme de machine à bas prix de revient.
- Mise au point d'une base de données pour l'ensemble de la gestion de la production.
- Programme de réduction de la complexité.
- Fusion des réseaux Poclain et Case dans le Réseau n° 1.
- Mise en place d'un système central de gestion des pièces de rechange au niveau européen.
Un « tableau de bord » fera le point chaque mois des actions menées.
En parallèle, un plan stratégique définit les politiques de l'entreprise dans chacun de ses secteurs d'activité, les objectifs qui en découlent et les moyens humains pour les atteindre. Outil de gestion du développement de l'entreprise, le Plan est l'instrument de la cohérence dans le temps de toutes les actions entreprises et à entreprendre, comme il est l'instrument de la cohérence de l'ensemble des politiques menées à l'intérieur de la Société. Il se veut à la fois un guide et un engagement de chaque Direction vis-à-vis des objectifs qui lui sont fixés.
Le lancement de la 61
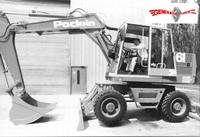
Le lancement d'une nouvelle pelle s'inscrit dans cette volonté de redonner souffle et vigueur à l'entreprise. Pour cette machine, les objectifs sont ambitieux : réduire les coûts de production de 20 % et offrir une pelle de conception nouvelle, intégrant expérience et évolution technologique, pour une mise en œuvre plus souple et plus rapide. La nécessité de repenser globalement le produit et la production va alors s'imposer. Il faut une nouvelle fois « réinventer la pelle hydraulique », de nouveau mobiliser dans tous les secteurs et à tous les niveaux le savoir-faire et l'esprit d'innovation des hommes. Avec succès. En 1985, la nouvelle machine, la 61 P est présentée au personnel et au réseau international. Cette pelle est modulaire par construction. Elle obéit dans sa globalité aux nouveaux critères d'économie qui s'inscrivent directement dans la forme des composants et des modules eux-mêmes. Ce choix permet d'améliorer en outre la maintenance et l'entretien courant. La qualité et l'esthétique répondent eux-aussi à ces critères. De même, au plan industriel, il a fallu repenser tous les concepts et les moyens de production. L'usine de Crépy a été choisie pour cette mission et, à l'issue d'investissements importants, s'en est trouvée complètement transformée.
Après la 61 P, ces principes de base donneront naissance à la pelle 61 CK puis à la série 81. Ils prouvent, à l'évidence, les ressources de l'entreprise, une entreprise qui en 1985, avait déposé au cours de son histoire plus de 230 brevets concernant les pelles et plus de 75, les composants hydrauliques.


 Pour Poclain, 1978 voit un retour à l'équilibre. Les ventes en France se sont raffermies, le marché semble redémarrer. Pierre Bataille est toujours président du Groupe français et, avec son accord, un américain, David S. Bigelow, est nommé en 1980 directeur de la Division Pelles. En fait, de 1978 à 1981, durant quatre exercices, Poclain renoue avec les bons résultats : 2 155 millions de francs de chiffre d'affaires, 2 408, 2 747, enfin 3 153 en 1981 pour des bénéfices de 15, 100, 104 et 40 millions de francs. Les investissements suivent, passant de 28 millions de francs en 1978, à 31, 48, puis 92 millions en 1981. Au niveau de l'organisa?tion du groupe, il a été décidé de recentrer les activités sur les lignes de produits considérés comme prioritaires : les pelles, les grues et les composants hydrauliques. Les compacteurs sont abandonnés et Derrupé est cédé à la société allemande IBH. À l'inverse, les pelles électriques de forte puissance et une mini-pelle, la 35 CK, sont développées ainsi qu'une nouvelle gamme d'outils. En ce qui concerne la production, l'heure est à la spécialisation des usines par type de produit et au retour de certains travaux auparavant sous-traités. Pour une plus grande cohésion, les usines de l'Oise sont regroupées sous une direction unique et la liaison logistique Production-Commercial est renforcée. De 1978 à 1981, les investissements les plus importants concernent les pelles et les grues. Les dépenses engagées, comme l'achat d'installations à commandes numériques à hautes performances, visent toutes à améliorer la productivité. Les effectifs, eux, se maintiennent à peu près au même niveau, baissant légèrement pour le groupe de 7 265 à 7 243 et augmentant pour Poclain SA de 3 408 à 3 522. Formation et information sont deux leitmotive de la société. En 1979, 900 personnes ont participé à un stage de formation, un chiffre en augmentation de 30 % sur l'année précédente. Quant à l'information, elle est consolidée verticalement par une meilleure circulation des résultats de l'entreprise, des évolutions de l'environnement, du marché et de la concurrence. Un Comité de coordination du Groupe est également instauré, comprenant 14 membres sous la présidence de Pierre Bataille. Mêmes efforts pour les relations horizontales entre les services et les directions des divisions. Plus globalement, cette politique volontaire en matière d'information et de communication s'appuie toujours sur les deux publications de l'entreprise, « Poclain Journal » et « lnter-Poclain ».
Pour Poclain, 1978 voit un retour à l'équilibre. Les ventes en France se sont raffermies, le marché semble redémarrer. Pierre Bataille est toujours président du Groupe français et, avec son accord, un américain, David S. Bigelow, est nommé en 1980 directeur de la Division Pelles. En fait, de 1978 à 1981, durant quatre exercices, Poclain renoue avec les bons résultats : 2 155 millions de francs de chiffre d'affaires, 2 408, 2 747, enfin 3 153 en 1981 pour des bénéfices de 15, 100, 104 et 40 millions de francs. Les investissements suivent, passant de 28 millions de francs en 1978, à 31, 48, puis 92 millions en 1981. Au niveau de l'organisa?tion du groupe, il a été décidé de recentrer les activités sur les lignes de produits considérés comme prioritaires : les pelles, les grues et les composants hydrauliques. Les compacteurs sont abandonnés et Derrupé est cédé à la société allemande IBH. À l'inverse, les pelles électriques de forte puissance et une mini-pelle, la 35 CK, sont développées ainsi qu'une nouvelle gamme d'outils. En ce qui concerne la production, l'heure est à la spécialisation des usines par type de produit et au retour de certains travaux auparavant sous-traités. Pour une plus grande cohésion, les usines de l'Oise sont regroupées sous une direction unique et la liaison logistique Production-Commercial est renforcée. De 1978 à 1981, les investissements les plus importants concernent les pelles et les grues. Les dépenses engagées, comme l'achat d'installations à commandes numériques à hautes performances, visent toutes à améliorer la productivité. Les effectifs, eux, se maintiennent à peu près au même niveau, baissant légèrement pour le groupe de 7 265 à 7 243 et augmentant pour Poclain SA de 3 408 à 3 522. Formation et information sont deux leitmotive de la société. En 1979, 900 personnes ont participé à un stage de formation, un chiffre en augmentation de 30 % sur l'année précédente. Quant à l'information, elle est consolidée verticalement par une meilleure circulation des résultats de l'entreprise, des évolutions de l'environnement, du marché et de la concurrence. Un Comité de coordination du Groupe est également instauré, comprenant 14 membres sous la présidence de Pierre Bataille. Mêmes efforts pour les relations horizontales entre les services et les directions des divisions. Plus globalement, cette politique volontaire en matière d'information et de communication s'appuie toujours sur les deux publications de l'entreprise, « Poclain Journal » et « lnter-Poclain ».
 La célébration du cinquantenaire de Poclain et l'organisation d'un Prix Georges Bataille en 1980, la création de l'Ordre du Mérite Poclain l'année suivante, forment un faisceau de manifestations destiné à forger un peu plus l'identité de l'entreprise. Le commercial n'est pas oublié et, à Expomat 1981, le Groupe lance l'opération « Poclain Max », campagne destinée à valoriser l'ensemble des services Poclain. Dans ce but, les effectifs de l'assistance technique sont augmentés. Du côté du réseau, si Poclain devient le premier distributeur Volvo BM dans le monde, hors Suède, l'entreprise est dans l'obligation de racheter trois concessionnaires en difficulté, à Dijon, Bourges et Rouen. Ces reprises sont révélatrices.
Alors qu'à l'étranger la situation s'est améliorée, permettant, au moins provisoirement, la restauration des grands équilibres économiques mondiaux, en France, la conjoncture reste médiocre. Taux fiscaux élevés, crédit étroitement encadré, programmes d'investissements limités pèsent sur l'économie du pays. En cinq ans, de 1975 à 1980, les dépenses salariales ont augmenté de 74 % alors que l'indice des prix industriel progressait de 40 % et celui des prix à la consommation de 47 %. Ce malaise va se transformer en véritable crise lorsque le marché mondial chutera une nouvelle fois à partir du deuxième semestre 1981. Cette année-là, Poclain gagnera pourtant encore des parts de marché.
La célébration du cinquantenaire de Poclain et l'organisation d'un Prix Georges Bataille en 1980, la création de l'Ordre du Mérite Poclain l'année suivante, forment un faisceau de manifestations destiné à forger un peu plus l'identité de l'entreprise. Le commercial n'est pas oublié et, à Expomat 1981, le Groupe lance l'opération « Poclain Max », campagne destinée à valoriser l'ensemble des services Poclain. Dans ce but, les effectifs de l'assistance technique sont augmentés. Du côté du réseau, si Poclain devient le premier distributeur Volvo BM dans le monde, hors Suède, l'entreprise est dans l'obligation de racheter trois concessionnaires en difficulté, à Dijon, Bourges et Rouen. Ces reprises sont révélatrices.
Alors qu'à l'étranger la situation s'est améliorée, permettant, au moins provisoirement, la restauration des grands équilibres économiques mondiaux, en France, la conjoncture reste médiocre. Taux fiscaux élevés, crédit étroitement encadré, programmes d'investissements limités pèsent sur l'économie du pays. En cinq ans, de 1975 à 1980, les dépenses salariales ont augmenté de 74 % alors que l'indice des prix industriel progressait de 40 % et celui des prix à la consommation de 47 %. Ce malaise va se transformer en véritable crise lorsque le marché mondial chutera une nouvelle fois à partir du deuxième semestre 1981. Cette année-là, Poclain gagnera pourtant encore des parts de marché.